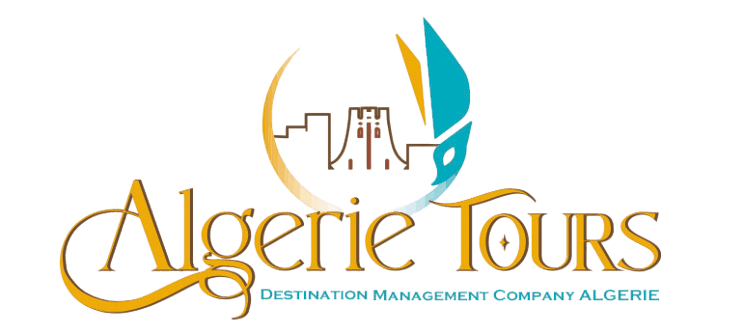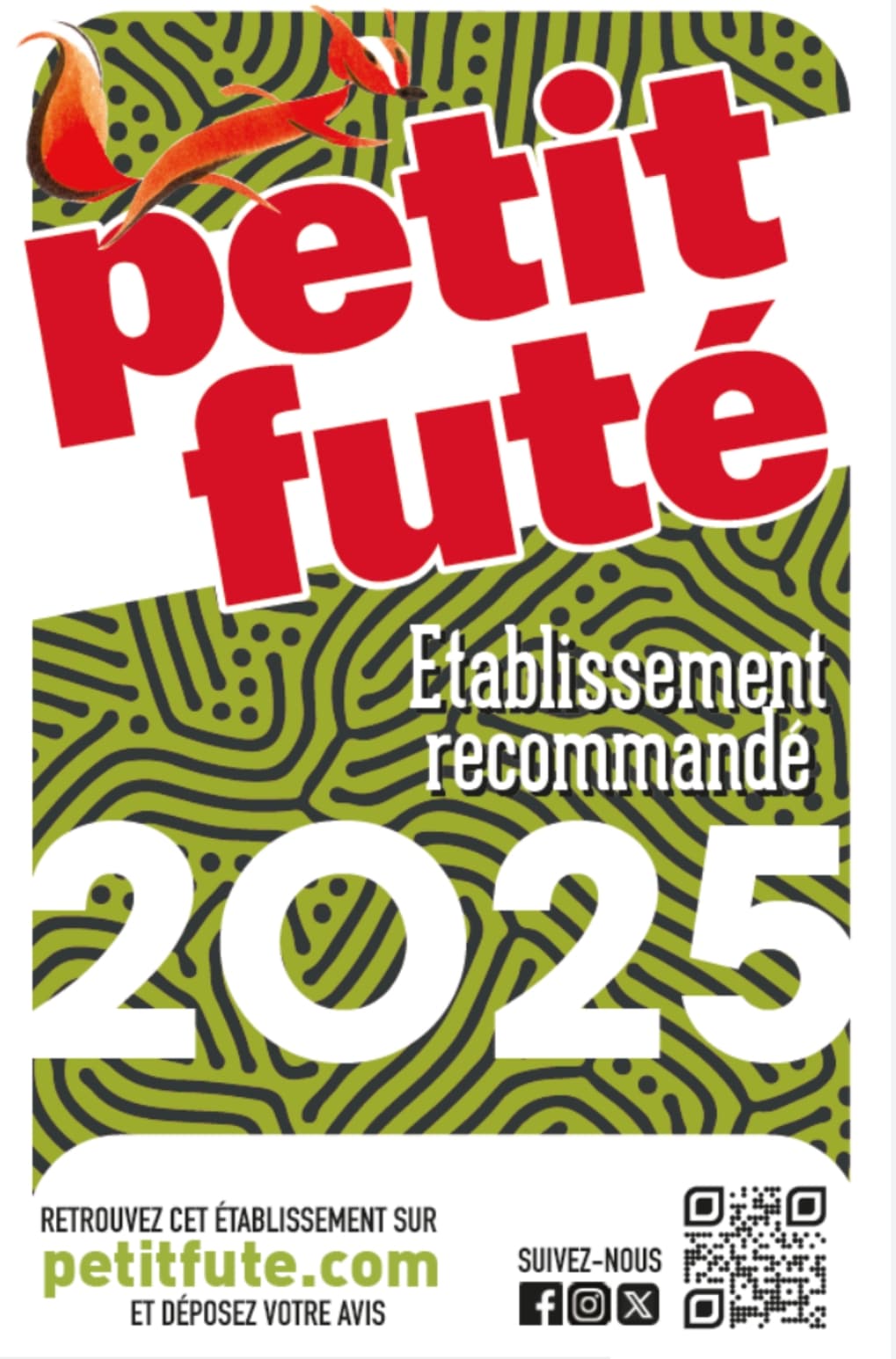L’Algérie vient de franchir un pas significatif dans la reconnaissance et la sauvegarde de son patrimoine en inscrivant onze nouveaux sites sur sa liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette mise à jour stratégique, présentée lors d’une conférence scientifique au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, n’est pas un simple exercice administratif : elle traduit une vision ambitieuse, profondément enracinée dans la volonté de protéger, valoriser et transmettre l’héritage exceptionnel du pays.
Une diversité exceptionnelle de sites, reflet d’une nation aux multiples visages
Les onze sites proposés couvrent un spectre d’une rare richesse, à la fois géographique, historique et symbolique. Des montagnes verdoyantes du Nord aux vastes étendues désertiques du Sud, des vestiges antiques aux savoir-faire traditionnels, ils forment un kaléidoscope unique du génie humain et de la beauté naturelle algérienne.
Les trésors de la nature
Au cœur de la Kabylie, le Parc National de Djurdjura impressionne par ses paysages spectaculaires, ses forêts denses, ses falaises abruptes et ses gouffres vertigineux. Ce massif montagneux, véritable sanctuaire de biodiversité, abrite des espèces endémiques et constitue un lieu de randonnée et de spiritualité depuis des siècles. Il incarne une symbiose entre nature brute et culture locale.
À l’extrémité orientale du pays, le Parc National d’El Kala s’impose comme un joyau écologique d’une importance mondiale. Niché dans la wilaya d’El Tarf, ce site est célèbre pour ses lacs, marécages, forêts humides et zones littorales. Il accueille chaque année des milliers d’oiseaux migrateurs, ce qui lui vaut d’être reconnu comme zone humide d’importance internationale par la Convention de Ramsar. L’inscription à l’UNESCO viendrait renforcer les efforts de conservation de cet écosystème fragile.
Des paysages mixtes où la nature épouse la culture
Certains sites proposés relèvent d’une rare complémentarité entre patrimoine naturel et témoignages culturels anciens. C’est le cas de Tafedest, un ensemble montagneux situé dans le parc culturel de l’Ahaggar. Dans ce désert aux allures lunaires, les formations rocheuses millénaires côtoient des peintures rupestres et des récits immémoriaux liés à la culture touarègue. Ce lieu mythique inspire encore aujourd’hui écrivains, artistes et anthropologues du monde entier.
Les Balcons de Ghoufi et le site d’El Kantara, entre les wilayas de Batna et Biskra, illustrent aussi cette alchimie entre la force des éléments naturels et l’ingéniosité humaine. Les gorges spectaculaires des Balcons de Ghoufi, creusées par l’oued Abiod, révèlent des habitations troglodytiques construites dans les falaises. Ces architectures uniques s’intègrent au paysage de manière poétique et témoignent d’un mode de vie adapté aux contraintes environnementales.
Un patrimoine culturel aux racines profondes
L’Algérie, carrefour des civilisations, porte en elle une mémoire plurielle. Cette richesse culturelle se reflète dans plusieurs des sites proposés.
Les paysages culturels de Nedroma et Trara, dans la wilaya de Tlemcen, illustrent une cohabitation harmonieuse entre nature et culture. Ces terres agricoles, modelées par des générations d’agriculteurs et de bâtisseurs, racontent l’histoire d’une région marquée par l’influence andalouse, maghrébine et ottomane.
Dans la wilaya d’El Oued, le système d’irrigation traditionnel de Ghout démontre une intelligence hydraulique remarquable. En cultivant les palmiers-dattiers en creusant le sol jusqu’à atteindre la nappe phréatique, les habitants ont su créer des oasis en plein désert, transformant des terrains arides en havres de verdure. Ce patrimoine vivant reste encore aujourd’hui au cœur de l’agriculture locale.
Les ksour de l’Atlas saharien, dispersés entre Laghouat, El Bayadh et Naâma, témoignent de la tradition architecturale saharienne. Ces villages fortifiés, bâtis en terre crue, servaient à la fois d’abris contre les agressions extérieures et de centres d’échanges commerciaux. Ils racontent une histoire de résilience, de solidarité et d’organisation communautaire dans un environnement difficile.
Les mausolées royaux de l’Antiquité révèlent un pan méconnu de l’histoire préislamique du pays. Ces édifices majestueux, comme le célèbre Mausolée royal de Maurétanie (souvent appelé Tombeau de la Chrétienne), sont les témoins de la grandeur des royaumes numides et berbères, et de leurs liens avec Rome et Carthage.
La ville de Tébessa, quant à elle, incarne la profondeur historique de l’Algérie. Riche en vestiges romains, byzantins et islamiques, elle offre un aperçu saisissant de l’évolution urbaine et religieuse de la région au fil des siècles.
Dans le Sud-Ouest, les forteresses du parc culturel de Touat-Gourara-Tidikelt rappellent le rôle central joué par ces régions dans les échanges transsahariens. Ces ouvrages défensifs, construits en pisé, protégeaient les caravanes, les oasis et les lieux de savoir. Ils sont aujourd’hui les témoins silencieux d’un passé vibrant de commerce, de spiritualité et de rencontre interculturelle.
Enfin, les sites augustiniens, éparpillés dans plusieurs wilayas de l’Est et du Centre, forment un réseau de lieux liés à la vie et à l’œuvre de Saint Augustin. Né à Thagaste (Souk Ahras) et évêque d’Hippone (Annaba), ce penseur d’envergure mondiale a profondément influencé la philosophie chrétienne et occidentale. L’inscription de ces sites serait une reconnaissance internationale du rôle de l’Algérie dans l’histoire intellectuelle de l’humanité.
Un plan d’action structuré et une vision tournée vers l’avenir
L’actualisation de la liste indicative de l’Algérie s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action quinquennal, couvrant la période 2025 à 2029. Ce programme vise à préparer de manière méthodique les dossiers de candidature pour une inscription définitive à l’UNESCO. Il mobilise des experts en patrimoine, des institutions locales, des universitaires et des représentants de la société civile.
Cette stratégie ne se limite pas à l’aspect administratif. Elle entend développer le tourisme culturel et durable, renforcer la conscience patrimoniale chez les citoyens, promouvoir la formation dans les métiers de la conservation, et assurer une gestion intégrée des sites en partenariat avec les communautés locales.
Une Algérie fière de ses racines, ouverte au monde
Par cette initiative ambitieuse, l’Algérie affirme avec force son attachement à son histoire, à sa diversité culturelle, et à la beauté de ses paysages. Elle envoie un message clair à la communauté internationale : celui d’un pays résolument tourné vers la préservation de son héritage, mais aussi prêt à le partager avec le monde.
L’inscription éventuelle de ces sites au patrimoine mondial renforcerait non seulement l’image de l’Algérie à l’échelle globale, mais contribuerait aussi à une meilleure connaissance de son rôle dans l’histoire de l’humanité. Car préserver le patrimoine, ce n’est pas regarder vers le passé, c’est construire un avenir plus ancré, plus conscient, et plus harmonieux.
L’Algérie avance, elle avance avec ses pierres, ses arbres, ses histoires, et surtout avec sa mémoire vivante.